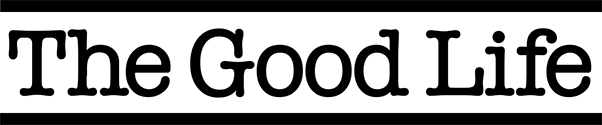Êtes-vous artiste, photographe portraitiste ou photographe
de mode ?
Photographe de mode, sûrement pas ! Artiste, c’est un trop grand mot. La première fois que j’ai dit que j’étais « photographe », j’étais très heureuse : c’est un beau mot. J’aime beaucoup les mots.
Vous avez d’abord été mannequin à New York dans les années 70…
Je venais juste d’avoir mon bac. J’étais censée faire du droit pour reprendre l’étude de commissaire-priseur de mon père (Maurice Rheims, NDLR), mais j’ai arrêté aussitôt après avoir commencé. Mon stage à l’hôtel Drouot se passait bien, mais le rapport entre l’objet d’art et l’argent me dérangeait. Je me suis mariée jeune et suis aussitôt partie vivre à New York. On n’avait pas un centime, j’ai donc été mannequin par nécessité. L’idée me plaisait beaucoup. À l’agence Ford Models, ça a duré près de deux ans. Ça marchait bien, mon accent français
charmait, j’étais appelée par de bons photographes – mais pas les plus grands comme Richard Avedon ou Irving Penn… De retour à Paris, ça marchait moins bien, je travaillais pour Jours de France (rires) !
Quels souvenirs gardez-vous de vos premières photos ?
Enfant, j’en faisais beaucoup : des portraits de ma sœur Nathalie… Avec mon camarade de classe Jean Touitou (fondateur de la marque de prêt-à-porter APC, NDLR), on avait monté le club photo de notre école. Pendant Mai 68, on passait nos soirées enfermés dans mon labo à tirer des clichés. Personne ne pouvait entrer. Quand la lumière rouge était allumée, on me fichait la paix. Ado, j’étais en guerre contre ma famille. Puis, à New York, j’ai oublié la photographie.
C’est votre rencontre avec Serge Bramly qui va vous remettre sur la piste de la photo…
Il était marié, moi aussi. On est devenus amis, puis on s’est revus à Paris, on déjeunait à La Coupole… J’ai alors exercé des petits métiers, des expériences ubuesques, de journaliste par exemple. Un jour, j’ai interviewé un footballeur et je lui ai demandé combien ils étaient dans son équipe : mon rédacteur en chef m’a virée ! Je n’étais pas quelqu’un d’intéressant. Rien ne me plaisait plus que de faire la fête avec les copains. Voilà, je n’avais pas de plan ! Le reste, c’est le hasard et le destin. Au même moment, je me suis associée à un ami qui voulait ouvrir une galerie d’art près de Beaubourg, alors qu’il n’y avait pas encore le Centre Pompidou, c’était juste un trou avec des grues : la Galerie Gerald Piltzer. Puis, un jour, Serge m’a dit qu’il fallait que je fasse quelque chose… On en a parlé un soir et le lendemain il m’offrait un appareil photo chiné aux puces ! Pendant qu’il écrivait son premier roman, moi, je produisais mes vraies premières photos… J’allais à Pigalle photographier des strip-teaseuses, en noir et blanc (1980), puis je gardais les tirages dans des boîtes.
Et c’est aussi Serge Bramly qui a initié le projet « Chambre close » (1990-1992)…
Oui. Il me raconte l’histoire de monsieur X, un élégant banquier (probablement) âgé qui, en cachette de sa famille et de ses associés, arrête des filles dans la rue pour leur demander de monter dans une chambre d’hôtel. Il ne les touche pas, il les prend en photo et garde les tirages. Quand il tombe gravement malade, il lègue à deux marchands ses photos à la condition de rester anonyme… Lorsque je demande à Serge où sont les photos, il me sourit : « Tu ne peux pas les voir, mais tu peux les faire si tu veux. » Là, je me suis retrouvée confrontée à l’obligation de faire ce casting : accoster des femmes dans Paris pour leur proposer ce marché étrange… Depuis lors, une fois qu’on a signé un contrat avec moi, c’est fini, on ne peut plus reculer, c’est un pacte (rires) !
Un jour, vos strip-teaseuses sortent de votre « boîte » et Helmut Newton vous appelle…
Nicole Wisniak (une ancienne connaissance de lycée devenue fondatrice et directrice du magazine Égoïste, NDLR) les découvre et les publie dans un grand portfolio. Au même moment, elles sont aussi dans Photo grâce au directeur artistique de presse Régis Pagniez. Newton était le photographe principal d’Égoïste à cette époque. C’est lui qui a demandé à me rencontrer. J’aimais énormément ses photos, mais mon inspiration venait plutôt de Diane Arbus. J’étais éprise d’elle, fascinée par sa vie, ses sujets photographiques, ses textes magnifiques… Le premier livre de photo que j’ai acheté était un livre d’elle. Bref, Newton m’a présenté son agent, celui aussi de David Bailey et David Hamilton, qui m’a prise parce qu’on lui reprochait de ne pas miser assez sur de jeunes photographes, qu’il ne prenait pas de risques, en somme ! Grâce à lui et à la pub, j’ai gagné ma vie. Je ne pensais pas que cela pouvait être possible. Je me souviens de mon premier cachet de 5 000 francs, c’était beaucoup d’argent pour quelques heures de travail. Je me suis dit : c’est génial ce truc !
En quoi les directeurs de votre première galerie (Texbraun), Hugues Autexier et François Braunschweig, ont-ils été précurseurs dans la promotion de la photographie contemporaine auprès des collectionneurs et des musées français ?
Au départ, ils vendaient de la photographie ancienne : Gustave Le Gray et consorts. Puis, très tôt, ils ont montré Robert Mapplethorpe et Pierre & Gilles, alors que la mode était à la photographie documentaire et historique (ils ont d’ailleurs développé la collection du musée d’Orsay). Ma relation avec eux fut dense et brève. Ils sont partis en 1986. Je ne suis pas bonne avec le temps, les dates ; je me repère par rapport aux gens qui me manquent…
Quel regard portez-vous sur la production photographique actuelle ?
Quand j’ai du temps libre, je ne regarde pas forcément de la photographie, même si ça me prend parfois d’acheter des magazines par piles. Les photographes de mode sont relativement bien publiés aujourd’hui par les revues indépendantes, mais notre période créative est flottante et morne… Il faut donner au public l’impression de tout maîtriser, de toucher à tout : faire de l’image, du film, de l’installation. Désormais, les photographes veulent d’abord se définir comme plasticiens et « faire de l’art contemporain ».
Vous avez aussi débuté en écrivant des listes de personnalités à portraiturer. Charlotte Rampling fut la première à accepter en 1979…
J’ai eu cette idée – qui n’a jamais vraiment marché – de lister des acteurs pour les contacter et leur demander d’accepter d’être pris en photo afin qu’à leur tour ils demandent à d’autres… Mais j’ai toujours fait des listes, de mots notamment. En fait, je suis plus sensible à la manière dont les gens parlent qu’à leur physique. C’est vrai que c’est bizarre pour une photographe…
Aviez-vous le sentiment de toucher à quelque chose de nouveau avec « Chambre close » ?
Non. Je ne savais rien quand j’ai commencé : je mettais mes spots à l’envers… Ça donnait des images de films d’horreur ! C’est quand j’ai assisté le photographe de mode Gilles Bensimon que j’ai compris ce qu’étaient une lumière et un flash. Avant, très naïve, je passais des heures à composer mes décors, dans le mythe que je m’étais construit des mises en scène de Diane Arbus. Avec le recul, ces photos restent très « crues », dans leur jus. Je n’ai jamais voulu faire plaisir aux gens que je photographiais, je voulais juste garder leur image dans mes boîtes. Avec les célébrités, c’est effectivement biaisé : on met des garde-fous, il faut jouer avec les ego…
Quid du premier portrait de Kate Moss en 1989, de vos photographies de transsexuels, de « Modern Lovers » (1990) à « Gender Studies » (2011) ? Aujourd’hui, on parle beaucoup de la « gender fluidity » à travers les individus de la génération Y…
À Londres, les gens étaient plus rock et androgynes, ce qui est toujours le cas. Je faisais le casting pour « Modern Lovers » quand, un jeudi après-midi, Kate Moss a débarqué à l’agence, son sac de collégienne sur le dos. Elle était à l’opposé de la tendance des filles pulpeuses. Et c’était elle que je voulais. « Modern Lovers » est arrivée à un moment étrange de ma vie : mon frère venait de mourir, la famille était dévastée, je travaillais beaucoup et, lors d’un casting, j’ai rencontré deux personnages : Josie (1989), qui a les cheveux courts et un corps incroyablement féminin avec une belle poitrine, et Cameron (1989), une sorte de Jésus avec des cheveux longs, très beau. En les sélectionnant, j’ai pensé qu’un phénomène nouveau émergeait. Comme une coïncidence, en rentrant à Paris, Jean Paul Gaultier (qui avait fait le stylisme de cette série) me confiait son envie de faire défiler des mannequins non professionnels. Au fond, j’ai toujours eu le sentiment d’avoir ouvert des portes un peu trop tôt et de les avoir ouvertes en grand ! Quand « Chambre close » sort, c’est un scandale, d’autant plus important que j’étais une femme. À l’époque, le sexe en photo était mercantile et morbide. Il se découvrait à travers le regard masculin dans des titres tels que Playboy, et c’était sordide… La photographie artistique était encore habituellement en noir et blanc. De mon côté, c’était mes premiers clichés en couleur.
Vous aimez résumer vos séances photo comme « des histoires d’amour »…
Oui, enfin des histoires brèves. Ça ne dure pas longtemps…