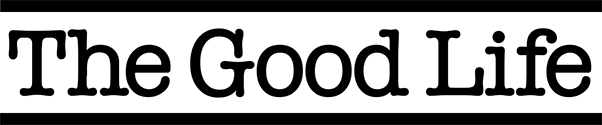comme le sexe. Quand c’est fini, c’est terminé. « Chambre close » n’avait pas de script, j’accumulais juste des images de jeunes femmes. Et un jour, j’ai su que j’avais fini la série.
Fantasmez-vous vos images au préalable ?
Mes fantasmes proviennent de références qui surgissent dans ma tête avant et pendant le shooting. Les décors et accessoires sont mis en place au préalable pour que cette « chose » puisse se produire, ou pas. C’est seulement quand je parle aux filles que je vais photographier, que je passe un moment avec elles, entre les prises, pour mieux les comprendre, que j’arrive à construire ou reconstruire une histoire. Un jour, je n’y parviendrai plus.
Votre travail sur la prise de vue tient de la performance…
Il consiste à créer une intimité avec la personne photographiée pour qu’elle se dévoile au fur et à mesure. Cela peut prendre des secondes comme des années, de séries en séries… C’est comme être le général d’une armée et le metteur en scène d’un peep-show à la fois : c’est du happening ! J’ai appris, sans repentir.
À vos débuts, vous alliez faire vos tirages à Düsseldorf…
Parce qu’il n’y avait pas de machine en France à l’époque où je devais livrer à Texbraun ma série des animaux empaillés. Je voulais les tirages très grands.
Est-ce que vous pensez à l’exposition, voire au livre, avant de photographier ?
Le livre, oui. L’exposition, non. C’est quand le tirage est fini, qu’on fait plusieurs essais de taille et qu’on les punaise au mur de mon studio… J’aime tirer à la dimension réelle du sujet ou, au contraire, petit, pour gagner en intimité dans la présentation sur papier ou dans un espace. Aujourd’hui, tout le monde tire en grand dans l’optique de vendre cher.
Combien valaient vos photos à vos débuts ?
1 500 francs. Contre 150 dollars pour Mapplethorpe, une aubaine (rires) ! Lors de ma première exposition, j’en ai vendu deux : une à mon cousin et une autre à mon dentiste, j’étais très fière !
Vos collectionneurs ?
Je ne les connais pas, je ne demande pas. Cela m’est égal. Mais c’est vrai que quand je reconnais une image de moi dans un magazine de déco, ça me fait plaisir.
L’artiste Jean-Marc Bustamante fut l’un des premiers à exposer vos photos…
La série des strip-teaseuses. C’est lui qui a ouvert cette première boîte avant la parution dans Égoïste. Il a aussi exposé Sophie Calle. C’était, je crois, dans l’appartement de ses parents qui étaient partis en vacances… Un truc pirate très excitant ! Un peu plus tard, en 1988, j’ai ouvert mon second studio dans le Marais.
À quel moment votre signature fut-elle une carte à jouer pour convaincre vos clients de la publicité ?
Assez vite. J’expliquais que je pouvais tout faire et ils acceptaient tous. J’ai donc fait des campagnes où des filles mangeaient des sandwichs, agitaient des cuillères à moutarde et portaient de la lingerie moche… On est d’abord venu pour mon travail personnel, ensuite pour ma notoriété en essayant de me faire faire autre chose, pour utiliser mon nom… Le malaise autour de mon travail entre l’art et la photographie commerciale a de ce fait toujours existé en France, surtout auprès des institutions. Alors que Man Ray a aussi vécu grâce à des commandes. Qu’une image montrant une femme portant une robe Vivienne Westwood déchirée soit faite pour moi, par moi ou pour la marque n’a pas d’importance : c’est la photo qui compte. [Elle fait référence à Fawnya Frolic looking like a fetish doll (juin 2013, Londres), de la série « Bonkers! », accrochée sous nos yeux, dans son bureau, NDLR.]
Aimez-vous que l’on vous déteste ?
Je m’en suis toujours fichu. C’est ma force. Quand mes parents étaient vivants, c’était plus difficile parce que je savais que ça pouvait les faire souffrir. Le jour où j’ai eu un appareil photo dans la main, je me suis dit que je croyais en la vie. Les gens ne m’ont pas trop aimée à cause de mon nom, parce que je suis une bourgeoise, parce qu’on préfère communément les artistes torturés qui triment. Moi, je vais chercher mes propres financements à la manière de la production d’un film à petit budget. Pour « Rose, c’est Paris » (avec Serge Bramly, 2010), j’ai répondu à l’invitation de Bruno Racine (président de la BNF) qui souhaitait exposer mon travail, en trouvant un sponsor : le champagne Louis Roederer. C’est important de les citer, on ne le fait jamais. D’autres fois, je suis partie à l’étranger sans limite de temps ni prêt d’argent : ce fut le cas pour la série « Shanghai » (2002), où je suis restée près d’un an.
Vous avez réalisé une trentaine de pubs et de vidéos. Passer à l’image animée, c’était un défi ?
On est venu me chercher pour réaliser le clip de Desireless, Voyage Voyage (1986). C’était juste après 37°2 le matin (de Jean-Jacques Beineix, 1986) et la productrice du film, Claudie Ossard, m’a donné tout son staff, caméraman inclus. Comme j’étais photographe et pas cinéaste, je criais « coupez ! » toujours trop tôt et… les rushs étaient « immontables » (rires).
Quel cinéma vous inspire ?
Celui de Luis Buñuel, David Lynch bien sûr, Alfred Hitchcock, John Waters, Paul Verhoeven et un peu de Pedro Almodóvar.
Et l’histoire de l’art ? La figure de la femme à la toilette, présente en creux dans votre œuvre, la sculpture d’Auguste Rodin, le clair-obscur du Caravage ? Durant votre enfance, Pablo Picasso et Balthus étaient aussi des hôtes réguliers de la famille…
Ces références que j’adore m’inspirent plus inconsciemment aujourd’hui. Je « collectionne » des tableaux de musées dans ma mémoire… Je les photographie au portable, j’achète des cartes postales de reproductions.
Que retenez-vous de votre père ? Il vous emmenait dans les musées, mais aussi dans les cimetières, pour en admirer la statuaire…
Un homme très occupé. Il disait toujours : « Mes enfants, je ne vous retiens pas », alors qu’on venait d’arriver (rires) ! Bien sûr, on avait des discussions sur mon travail et il s’est battu pour me soutenir à l’Académie française au moment du scandale d’« INRI » (son cycle de scènes de la vie du Christ, en 1998, NDLR). Il aimait beaucoup « Chambre close ». Il adorait qu’on lui tienne tête, la transgression l’intéressait… Comme moi, en fait.
Et de votre mère ?
(Long silence.) J’aimais beaucoup ma mère. C’est une femme qui a été écrasée par un homme toujours dans la lumière. Puis une fille aussi dans la lumière… Elle était très belle. Par exemple, je me souviens très bien que, petits, on avait le droit de descendre la voir dans sa chambre quand, les grands soirs, elle se faisait faire un chignon par son coiffeur. Descendre cet escalier, marcher dans ce couloir interminable pour arriver finalement dans cette chambre, et la voir, de dos, pour lui dire bonsoir… J’ai beaucoup de mal à photographier les gens de dos.
D’où vient votre fascination pour l’érotisme ?
De l’histoire de l’art et… Honnêtement, je ne sais pas. L’érotisme fait partie de nos vies à tous.
Comment expliquez-vous que vous ayez photographié si peu d’hommes ? En 1982, votre portrait de Serge Gainsbourg le montre déguisé en femme auprès de son garde du corps. L’homme est-il une femme comme les autres ?
L’homme est moins complexe que la femme, moins multiple, plus simplet peut-être (rires). Je n’ai jamais eu envie de photographier des hommes, même si je l’ai fait et que je suis même tombée plusieurs fois amoureuse d’acteurs que je « capturais », mais il n’ont jamais eu envie de jouer au même jeu intime que les femmes, de briser leur image. Pourtant, j’ai une « boîte d’hommes nus », des prises de vue que j’avais faites à la demande des propriétaires de la galerie Texbraun, qui me suppliaient avec humour d’en réaliser pour leurs collectionneurs. Le résultat fut minable. Ce n’est quand même pas joli un homme nu, à part celui qui est dans votre lit !
Féministe, vous ?
On m’a taxée d’être féministe et d’être l’inverse aussi. En Allemagne, j’ai même été insultée ! Je l’ai toujours été, féministe, évidemment. Ma grand-mère s’est battue pour le droit de vote des femmes en France. Je le suis encore plus quand je vais au Moyen-Orient et en Asie. Mes héroïnes d’aujourd’hui, ce sont les femmes qui font de la résistance, anonymement, dans les pays islamiques, en Inde… (Elle fait une pause.) J’aimerais dire quelque chose que je n’arrive pas à formuler… Je n’ai pas photographié des gens que j’admirais pour leur courage ou pour leur intelligence. Mais je me suis servie de la beauté des femmes pour faire mon travail. Je le regrette parfois, car j’ai croisé des êtres brillants sans avoir eu envie de les photographier.
Votre œuvre photographique, c’est votre autoportrait ?
Si l’on superposait toutes mes photos pour obtenir ma tête, comme dit Serge, on serait épuisé ! Je pensais que j’allais devenir quelqu’un de plus intéressant. C’est effectivement un jeu de miroirs, car il y a quelque chose de profondément double chez moi, de masculin et de féminin à la fois. Ça m’a plu pendant des années d’être un camionneur le jour et une beauté le soir. Seules les femmes peuvent faire ça. Le genre et le trouble sexuel, ce sont des questions qu’on ne peut pas ne pas se poser quand on est née femme. Tout le monde devrait s’intéresser à explorer sa part de « l’autre » et savoir vivre avec. C’est ça qui est inouï chez les humains, non ?